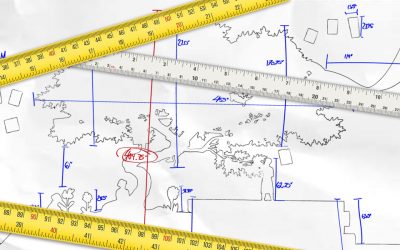Distinguer l’art décoratif de l’art thérapeutique
Dans un monde où l’apparence des lieux est de plus en plus valorisée, les initiatives visant à intégrer l’art dans les milieux de vie se multiplient. Couloirs d’hôpitaux, centres communautaires, CHSLD, écoles: partout, on souhaite égayer l’espace. Mais il est essentiel de ne pas confondre art décoratif et art thérapeutique. Si les deux peuvent partager des formes esthétiques similaires, leur fonction, leur conception et leur impact sont radicalement différents.
L’art décoratif : embellir, personnaliser, habiller
Caractéristiques de l’art décoratif en milieu institutionnel
- Créer une ambiance chaleureuse et accueillante
- Réduire l’aspect institutionnel froid des espaces
- Refléter l’identité de l’organisation ou de la communauté
- Stimuler visuellement l’environnement
Processus de création :
- Basé sur des considérations esthétiques générales
- Souvent conçu sans consultation approfondie des usagers
- Choix artistiques guidés par des préférences visuelles ou des contraintes budgétaires
- Intégration limitée des données probantes sur l’impact psychologique
Limites potentielles :
- Peut parfois créer une surstimulation visuelle
- Risque de ne pas correspondre aux besoins spécifiques des populations vulnérables
- Absence de mesures d’impact sur le bien-être réel des usagers

Utilisation de l’art thérapeutique en pédiatrie : murale du Centre de vaccination de Coaticook pour offrir un environnement apaisant et distrayant pendant la vaccination. (Projet MUR MURA 2025)

Initié par l’équipe du CHSLD Memphrémagog, ce projet a été créé avec la collaboration de plusieurs spécialistes afin de créer un espace chaleureux, apaisant et divertissant pouvant permettre aux résidents de retrouver la sensation du voyage, le temps d’une balade en train. (Projet MUR MURA, 2023)
L’art thérapeutique : une action ciblée sur le bien-être
Des travaux québécois et internationaux montrent que l’environnement joue un rôle clé dans le processus de guérison et le bien-être des patients. L’architecture de guérison (healing architecture) devient un outil thérapeutique qui peut contribuer positivement au traitement et à la récupération.¹
Principes fondamentaux de l’art thérapeutique
Approche centrée sur la personne : Contrairement à l’art décoratif, l’art thérapeutique commence par une analyse approfondie des besoins des personnes qui utiliseront l’espace. Pour une unité de soins palliatifs, on privilégiera des tons apaisants et des images évoquant la sérénité. Pour un centre de réadaptation, on optera pour des éléments visuels dynamiques qui stimulent la motivation et l’énergie.
Collaboration interdisciplinaire : La création d’art thérapeutique nécessite l’implication d’ergothérapeutes, de psychologues, d’infirmières, de travailleurs sociaux et parfois de neuropsychologues. Cette équipe multidisciplinaire assure que chaque intervention artistique répond à des objectifs thérapeutiques précis.
Ce que dit la science : approfondissement des recherches
1. Réduction du stress et de l’anxiété : comment notre corps réagit
Des études internationales ont montré que des patients exposés à des paysages naturels se remettaient plus vite.² Ce constat est confirmé par plusieurs recherches qui soulignent l’importance d’un environnement visuel apaisant (lumière douce, couleurs calmes, images de nature) dans la création de milieux de soins qui favorisent la guérison.
Mécanismes d’action :
- Réduction du cortisol : Les environnements apaisants diminuent la production de l’hormone du stress
- Activation du système parasympathique : Les couleurs douces et les formes organiques favorisent la relaxation
- Amélioration du rythme cardiaque : Un indicateur clé de la capacité de récupération de l’organisme
📘 Le saviez-vous ?
2. Stimulation cognitive et mémoire
Dans les CHSLD québécois, les experts comme Philippe Voyer (Université Laval) recommandent des aménagements visuels adaptés, incluant des éléments de camouflage artistique, pour réduire l’agitation et les comportements d’errance chez les personnes vivant avec des troubles de mémoire.⁴ Des études montrent que l’art thérapie et les environnements visuels bien pensés peuvent améliorer la qualité de vie, les interactions sociales et favoriser les échanges chez les personnes atteintes de démence ⁵.
Résultats observés : L’utilisation de murales thérapeutiques personnalisées selon l’histoire de vie des résidents est une pratique émergente dans plusieurs CHSLD québécois, visant à améliorer la qualité de vie des personnes hébergées.
3. Orientation spatiale et réduction de l’errance
Les recherches menées dans des unités spécialisées démontrent l’efficacité des repères visuels et des murales pour aider les personnes à s’orienter⁶. Au Québec, plusieurs CHSLD utilisent maintenant des murales trompe-l’œil pour camoufler les portes de sortie et réduire l’anxiété liée aux tentatives de fugue⁷. Ces techniques visuelles, combinées à l’intégration artistique de codes de couleurs, peuvent diminuer la confusion et favoriser l’orientation spatiale.
Stratégies de design qui fonctionnent :
- Codes couleur thérapeutiques : Utilisation de palettes spécifiques pour faciliter l’orientation
- Repères visuels progressifs : Création de parcours artistiques guidant naturellement les déplacements
- Illusions d’optique bénéfiques : Techniques visuelles réduisant la perception des barrières physiques
4. Renforcement du sentiment d’appartenance : créer ensemble
Les projets où les résidents participent à la création artistique montrent que cette implication renforce leur sentiment d’être importants et respectés. Ce processus participatif permet à l’art de raconter les histoires des personnes qui vivent dans ces espaces et de contribuer à leur bien-être.⁸
Méthodologies participatives :
- Ateliers de création collaborative : Implication directe des bénéficiaires dans le processus artistique
- Collecte de récits de vie : Intégration des histoires personnelles dans les œuvres
- Consultation continue : Évaluation et ajustement des interventions selon les retours des usagers
📘 Le saviez-vous ?
Les risques de l’art mal conçu : quand l’esthétique nuit
Un art décoratif non réfléchi peut créer une surcharge cognitive, particulièrement problématique pour les personnes vivant avec :
- Troubles du spectre de l’autisme : Hypersensibilité aux stimuli visuels
- Démence : Confusion accrue face à des environnements visuellement complexes
- Troubles anxieux : Augmentation du stress face à des éléments visuels chaotiques
Décalage culturel
L’art décoratif générique peut involontairement :
- Exclure certaines communautés culturelles
- Créer un sentiment d’aliénation chez les usagers
- Ignorer les codes visuels significatifs pour les populations desservies
Exemple illustratif : l’importance de la consultation
Pour illustrer l’importance de la consultation communautaire, imaginons un centre montréalais qui aurait commandé des murales colorées représentant des scènes urbaines dynamiques, pensant égayer l’espace. Si la clientèle principale était composée d’aînés immigrants, ces images pourraient être perçues comme stressantes et déconnectées de leurs références culturelles. Un tel projet devrait être repensé en consultation avec les usagers et les intervenants pour intégrer des éléments visuels apaisants et culturellement pertinents. Cet exemple hypothétique souligne l’importance cruciale de consulter les populations cibles avant toute intervention artistique.
Guide pratique : Comment identifier un art thérapeutique de qualité
Aspects techniques :
- Respect des normes d’accessibilité universelle
- Intégration de principes de design adapté aux besoins sensoriels
- Utilisation de matériaux durables et sécuritaires
Aspects thérapeutiques :
- Objectifs de bien-être clairement définis dès le départ
- Collaboration avec des professionnels de la santé
- Évaluation continue de l’impact sur les usagers
Aspects participatifs :
- Implication des usagers dans la conception
- Respect de la diversité culturelle
- Processus de rétroaction continue
L’EXPERTISE MUR MURA : L’ART AU SERVICE DU MIEUX-ÊTRE
C’est dans cette approche rigoureuse que s’inscrit le travail de Mur Mura. En combinant sensibilité artistique et connaissances scientifiques en psychologie environnementale, gérontologie et design de soins, Mur Mura collabore avec des établissements de santé, des écoles et des milieux communautaires pour créer des œuvres sur mesure qui répondent à des objectifs thérapeutiques précis.
Chaque murale est conçue à partir d’une évaluation approfondie du contexte et fait l’objet d’un accompagnement tout au long du processus. À travers ses projets, Mur Mura travaille pour que l’art soit reconnu comme un véritable outil de mieux-être, intégré de façon responsable et durable dans nos espaces de vie collectifs.
Conclusion : repenser l’art dans nos milieux de vie
Pour les gestionnaires d’établissements, les professionnels de la santé et les artistes, cette distinction est cruciale. Elle permet de faire des choix éclairés, d’optimiser les investissements et, surtout, de maximiser les bénéfices pour les personnes qui fréquentent ces espaces.
L’art thérapeutique représente une évolution naturelle de notre compréhension du rôle de l’environnement dans le bien-être humain. En combinant créativité artistique et rigueur scientifique, il ouvre la voie à des milieux de vie véritablement thérapeutiques, où chaque élément visuel contribue activement à la santé et au mieux-être des usagers.
L’avenir de nos institutions de soins, de nos écoles et de nos espaces communautaires passe par cette approche intégrée, où l’art devient un partenaire thérapeutique à part entière, au service de la dignité humaine et de la qualité de vie.
Références
- Sasson, Y., Raz, A., & Zohar, M. (1998). Healing environment in psychiatric hospital design. General Hospital Psychiatry, 20(2), 108-114.
- Ulrich, R. S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. Science, 224(4647), 420-421.
- Wiercioch-Kuzianik, K., & Bąbel, P. (2019). Color Hurts. The Effect of Color on Pain Perception. Pain Medicine, 20(10), 1955-1962.
- Voyer, P., & St-Jacques, S. (2013). Soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie (2e éd.). Saint-Laurent : ERPI.
- Chancellor, B., Duncan, A., & Chatterjee, A. (2014). Art therapy for Alzheimer’s disease and other dementias. Journal of Alzheimer’s Disease, 39(1), 1-11.
- Davis, R., & Weisbeck, C. (2016). Creating a Supportive Environment Using Cues for Wayfinding in Dementia. Journal of Gerontological Nursing, 42(3), 36-44.
- Radio-Canada. (2018, 20 août). Des murales pour tromper l’errance en CHSLD.
- Leask, C. F., et al. (2019). Framework, principles and recommendations for utilising participatory methodologies in the co-creation and evaluation of public health interventions. Research Involvement and Engagement, 5, 2.
- Hunter, M. R., Gillespie, B. W., & Chen, S. Y. P. (2019). Urban Nature Experiences Reduce Stress in the Context of Daily Life Based on Salivary Biomarkers. Frontiers in Psychology, 10, 722.
VOUS AIMEREZ AUSSI…
Guide complet : préparer votre projet de murale
7 minutesMUR MURAVous ressentez l'envie de transformer un mur nu en œuvre d'art qui raconte votre histoire ? Cette...
Créer du beau sans imposer sa vision: l’approche sensible de Mur Mura
6 minutesMUR MURADans un monde où le design oscille souvent entre tendances éphémères et visions autoritaires, Mur...
VOS QUESTIONS TECHNIQUES
Vous êtes nombreux à nous poser des questions techniques à propos de nos murales. Nous avons donc décidé de répondre à...